Le stress d’acculturation

Le stress d’acculturation fait référence à l’expérience plus prolongée de tension et d’adaptation continue à une nouvelle culture. Ce stress découle du processus d’acculturation, qui est le processus d’adaptation aux normes et valeurs d’une culture différente de la sienne. Il survient souvent après la phase initiale du choc culturel, lorsque la personne est confrontée à des défis constants dans sa vie quotidienne, dans son travail, ses relations sociales et son identité.
Les symptômes du stress d’acculturation incluent :
- Un sentiment de perte d’identité ou de confusion sur qui l’on est.
- Une lutte pour trouver un équilibre entre les valeurs et comportements de la culture d’origine et ceux de la culture d’accueil.
- Des difficultés persistantes à s’intégrer ou à établir des liens sociaux solides.
- Un sentiment de marginalisation ou d’isolement culturel, surtout si l’individu se sent rejeté par la société d’accueil.
- Désorientation face aux différences culturelles rencontrées
- Anxiété
Le stress d’acculturation est souvent plus diffus et de longue durée. Il résulte des défis quotidiens dans la gestion des différences culturelles sur le long terme et peut mener à des problèmes de santé mentale si l’individu ne parvient pas à trouver des stratégies efficaces d’adaptation.
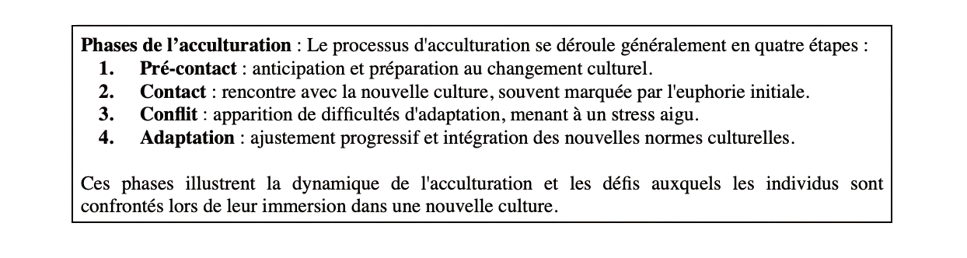
Impact sur le bien-être
L’acculturation peut influencer divers aspects de la vie quotidienne, tels que les habitudes alimentaires, qui jouent un rôle crucial dans le bien-être des expatriés. Une étude a révélé que s’ouvrir aux habitudes alimentaires locales favorise le bien-être général, tandis que s’y opposer peut accentuer le mal-être. S’installer dans un nouveau pays implique également de se constituer un nouveau cercle social ce qui peut s’avérer difficile avec la barrière linguistique et les différences culturelles. Pourtant l’absence de soutien social est un facteur de risque important pour la santé mentale et l’adaptation à ce nouvel environnement.
Facteurs influençant le stress d’acculturation
Plusieurs éléments peuvent exacerber le stress d’acculturation chez les expatriés :
- Défis financiers : l’adaptation à une nouvelle économie, avec des devises et des systèmes fiscaux différents, peut générer une pression financière significative.
- Mal du pays : la nostalgie du pays d’origine peut entraîner une insatisfaction générale et augmenter le niveau de stress.
- Accès aux soins de santé : la méconnaissance des systèmes de santé locaux peut être une source majeure d’anxiété.
Le choc culturel
Le choc culturel fait référence à la réaction initiale d’une personne lorsqu’elle se trouve confrontée à une culture nouvelle, souvent après un déménagement ou un voyage dans un pays étranger. Il se produit généralement au début de l’expatriation et est souvent perçu comme une sorte de « désorientation » face à des différences culturelles, sociales, et comportementales.
Les symptômes du choc culturel incluent :
- Un sentiment de confusion ou d’anxiété.
- Des frustrations liées à la difficulté de comprendre ou de s’adapter à des normes et des comportements inconnus.
- Un désir intense de retourner dans son pays d’origine.
- Un sentiment de solitude ou d’isolement.
Le choc culturel est souvent considéré comme une phase temporaire, qui peut durer quelques semaines ou mois, et il peut varier en intensité selon les individus et les cultures. Il est caractérisé par une réaction émotionnelle forte au décalage entre les attentes et la réalité vécue dans le pays d’accueil. Il ne s’agit pas d’un trouble.
Retour dans son pays d’origine

Le retour des expatriés dans leur pays de base représente également un défi important et se retrouve souvent sous-estimé autant au niveau des enjeux psychologiques, identitaires, et administratifs.
On parle alors de « stress d’acculturation inversée » ou « choc culturel inversé », un phénomène similaire à celui vécu dans le pays d’accueil. Les expatriés se sentent alors tout aussi déstabilisés à leur retour avec en plus la surprise d’éprouver un décalage important dans son propre pays. Le soulagement ressenti au moment du retour et le réconfort espéré peuvent être de courte durée, car il faut à nouveau s’adapter, naviguant entre son identité d’origine et celle façonnée au fil de l’expatriation. Le sentiment de ne plus être « chez soi » dans son propre pays peut entraîner une période de réajustement psychologique difficile.
Ressources pour Expatriés Français
- https://retourenfrance.fr/
- https://www.reseau-psyexpat.com/
- https://www.femmexpat.com/
- https://www.expat-pro.com/
Sources
- Bader, B., & Brousseau, C. (2019). L’adaptabilité du cadre expatrié : Revue critique de littérature, proposition et test d’une échelle. ResearchGate.
- Bakker, M. (2023, 8 novembre). Intégration : le défi de l’expatriation. Union des Français de l’Étranger. UFE
- Berry J.W. (1997), Immigration, acculturation, and adaptation, Applied Psychology : An International Review, 46 : 5-34
- Black et Mendenhall, 1991, The U-Curve adjustment hypothesis revisited: A review and theoretical framework
- Bourhis, R. Y., Moïse, L. C., Perreault, S., & Sénécal, S. (1997). Towards an interactive acculturation model: A social psychological approach. International Journal of Psychology, 32(6), 369-386.
- Études & Analyses. (s.d.). Mobilité internationale : Capacités d’intégration des expatriés et utilisation préférentielle des stratégies d’ajustement (coping). Études & Analyses. https://www.etudes-et-analyses.com/gestion-strategie/ressources-humaines/memoire/mobilite-internationale-capacites-integration-expatries-utilisation-preferentielle-strategies-ajustement-coping-325308.html
- Expat.com. (2023, 6 novembre). Épuisement professionnel et expatriation : Comment les expatriés restent résilients ? https://www.expat.com/fr/expat-mag/10180-epuisement-professionnel-et-expatriation-comment-les-expatries-restent-resilients.html
- Hellal-Guendouzi, R. et Dekhili, S. (2021) . Comment l’acculturation alimentaire influence-t-elle le bien-être des expatriés professionnels ? Décisions Marketing, N° 102(2), 53-80. https://doi.org/10.3917/dm.102.0053.
- Navas Luque, M., García, M. C., Sánchez, J., Rojas, A. J., Pumares, P., & Fernández, J. S. (2005). El modelo de aculturación relativa ampliado (MARA): Aplicación al estudio de la aculturación de inmigrantes y autóctonos en Andalucía. International Journal of Intercultural Relations, 29(1), 37-60.
- Navas Luque, M., Rojas Tejada, A. J., García, M. C., & Pumares, P. (2007). Acculturation strategies and attitudes according to the Relative Acculturation Extended Model (RAEM): The perspectives of natives versus immigrants. International Journal of Intercultural Relations, 31(1), 67-86.
- Piontkowski, U., Rohmann, A., & Florack, A. (2002). The role of acceptance and threat in acculturation among ethnic German immigrants. European Journal of Social Psychology, 32(6), 723-746.
- Safdar, S., Lay, C., & Struthers, W. (2003). The process of acculturation and basic goals: Testing a multidimensional individual difference acculturation model with Iranian immigrants in Canada. Applied Psychology, 52(4), 555-579.
- Sécurité Sociale d’Outre-Mer. (s.d.). Santé mentale et expatriation : Quels défis ? Sécurité Sociale d’Outre-Mer. https://www.securitesocialedoutremer.be/fr/blog/sante-mentale.html
- Vinsonneau, G. (2012). Mondialisation et identité culturelle. De Boeck Supérieur.
- Ward, C., & Kennedy, A. (1999). The measurement of sociocultural adaptation. International Journal of Intercultural Relations, 23(4), 659-677.
- Images par Freepik – www.freepik.com & Canva https://www.canva.com/